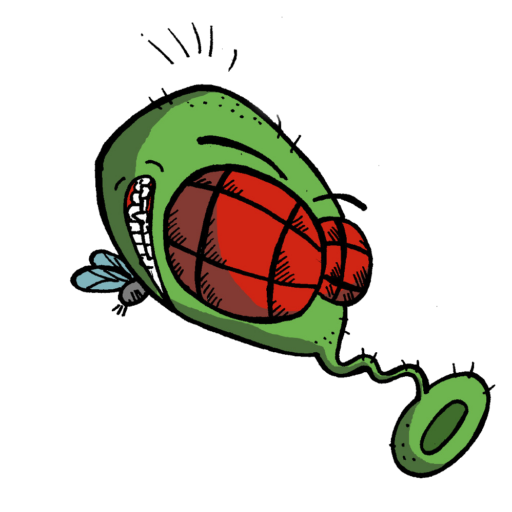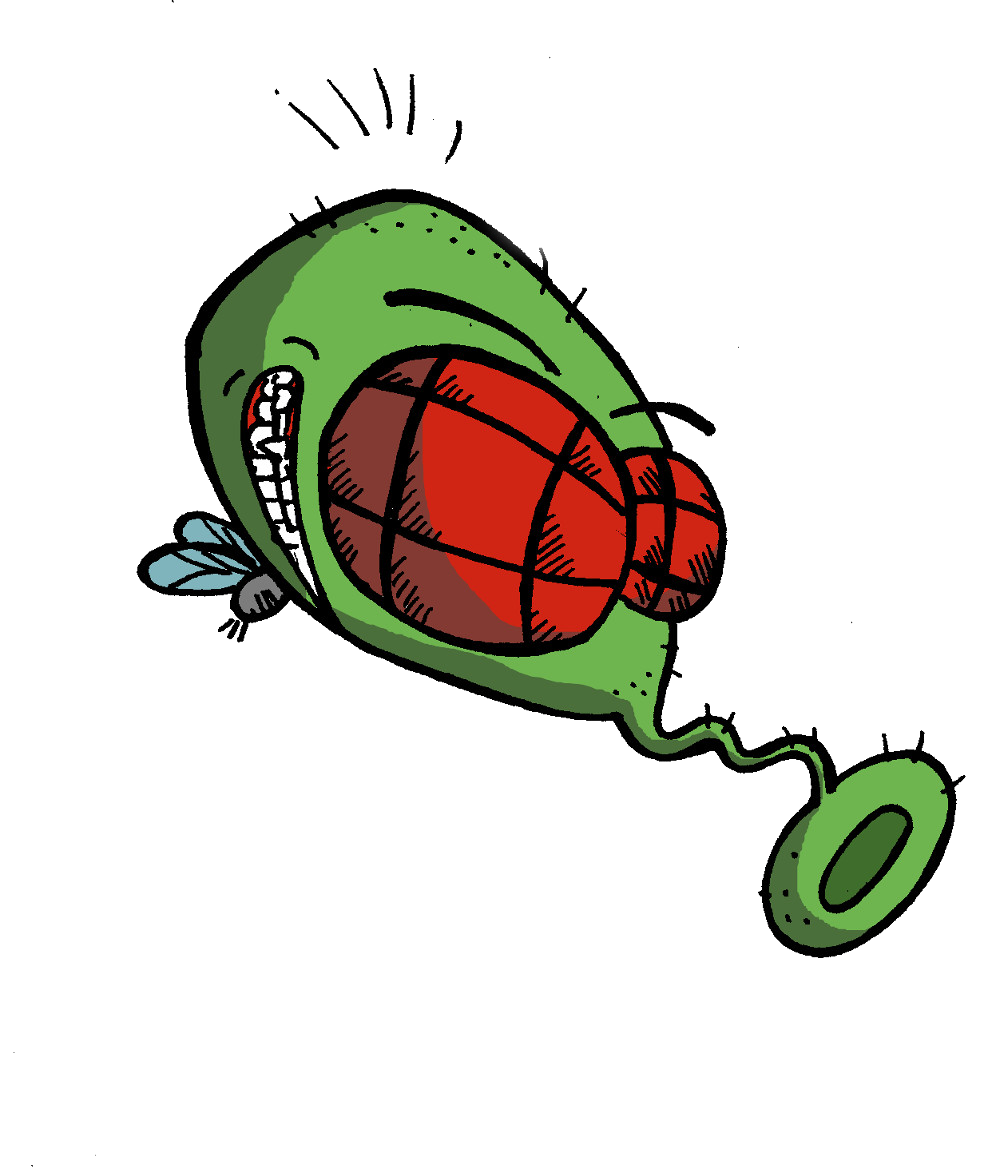Pointe-de-view : Comment ça va ici ? (par James Nettoyant-vitre)
a
a
a
Je m’étais juré de pas écrire face à la débauche d’articles qu’il y a déjà.
Mais, en discutant avec des amis, je réalise à quel point le sensationnel des médias ne transmet pas ce qu’il se passe ici pour de vrai, et justement pourquoi, vraiment, j’avais décidé de plus rien dire.
Comment ça va, ici ?
Déjà il faut évacuer la symbolique Parisienne, la capitale, la France, olalalah. Je me permets de raconter un peu, parce que j’y suis, et je voudrais en parler comme j’en parle à mes amis, parce qu’il se passe quelque chose de beau.
a
Comment dire.
Il n’y a rien de vendeur à décrire ce qu’il se passe ici.
A vrai dire, je sais pas vraiment par quoi commencer. Parce qu’il y a pas mal à dire.
Ca va, en surface, comme on essaye de reconstruire quelque chose après plusieurs ondes de choc.
De comment en ayant appris une putain d’hécatombe, en ayant passé une journée les yeux rivés sur Bfm et les infos qui tombaient, on emmerde l’état d’urgence et on se retrouve le soir, dans un appart, en petit comité, pour boire, fumer, manger et discuter de tout sauf de ça. C’est un rassemblement d’amis, d’amis d’amis et d’amis d’amis d’amis. Personne ne se connait vraiment mais on s’en fout, c’est bien de voir du monde. En rentrant, je me rends compte qu’en fait, il y avait un Néerlandais né en France et ayant vécu en Angleterre. Un Français dont le père est Indien et la mère Malgache. Un Français dont le père est Marocain, un autre dont la mère est Espagnole. Un Vietnamien. Des Français sans aucune originalité nés de parents Français eux même nés de parents Français. Et waow, dingue comme on s’en fout et qu’on continue à s’en foutre. Rien-à-péter. On mangeait de la pizza et on racontait des conneries.
a
Mais le dimanche après midi, ça ne va quand même pas. On sait qu’il y a la menace d’autres répliques mais dehors, il fait un soleil radieux. Ironique climat parisien.
Alors je sors quand même, et dans la rue, je croise des familles, les papys, les enfants, les boloss, les bobos, les clodos, et je sais pertinemment que tout le monde a la mort dans l’âme mais préfère sortir, voir les autres, et se prouver qu’on est vivants, se promener sur les quais, lire des bouquins.
Lundi, j’étais devant la Sorbonne pour la minute de silence. Les portes étaient ouvertes à 10h30 en prévision du monde qui allait venir. On s’est ramenés à 10h30 et on a pas pu entrer, trop, trop, trop de monde. Alors on était un peu énervés. A ma droite il y avait trois pétasses. Genre, les cheveux bien lissés, plâtrées de fond de teint et qui levaient leurs sourcils sur-épilés de cette façon insupportable en disant « Nonmaislesgensquooooiiii… ».
A ma gauche il y avait un mec, un bonnet enfoncé sur un visage barbu, en tunique et air max qui gueulait au téléphone « NAN WALLAH COUSIN SERRRIIEUUUX ? » « ARFARFARF WALLAH COUSIN J’Y CROIS PAS ».
a
Il était onze heure cinquante.
Et puis il a été onze heure cinquante huit et le gars a dit doucement au téléphone « Attends, attends, cousin, je te rappelle plus tard. ».
Il a sonné midi et les pétasses, le relou, ma petite personne et tous les étudiants sur la place, tout le monde a fermé sa gueule.
Le vent a soufflé.
J’ai réalisé que le relou à coté était venu tout seul. Par lui-même, donc.
Le vent a continué de souffler.
C’est très étrange le silence, quand un lieu est si densément investi qu’il n’y a pas 10 centimètres entre toi et tes voisins.
Bizarre que le discours le plus juste et fédérateur ne comporte pas un seul verbe.
Que ce soit son absence de mots qui me fasses réaliser que les pétasses, le relou et moi, on était tous là pour les mêmes raisons.
a
J’ai écouté la foule chanter la Marseillaise, le geste était beau mais un truc allait pas.
« Aux armes citoyens,
marchons, marchons
qu’un sang impur, abreuve nos sillons ».
Par exemple.
a
Rentrée chez moi, je me suis plantée devant mon ordi.
J’avais envie de gerber en lisant tout le ramassis de merde obscène et sans respect non seulement des médias mais aussi du petit ego de chacun s’imaginant, quoi, apôtre, justicier solitaire de l’internet bravant l’absurdité du monde par un statut Facebook ?
La honte de voir que le monde se soulève pour la France et lèvent son drapeau. Solidarité. Mon cul. Et Beyrouth ? La Syrie en général ?
J’étais blasée, tu sais ce moment où la stupidité, en avalanche, est telle qu’elle te laisse sans voix, sans autre perspective qu’un écœurement sans résolution.
Le soir, on a décidé d’aller à République avec un ami, poser une bougie.
Je suis passée devant ces putains de camions de reporters que j’avais envie d’insulter.
J’ai fait quelques pas et j’ai réalisé que toutes les dalles de la place étaient recouvertes de mots écrits à la craie. Elle est longue, cette place.
Des mots d’amour, de paix, qui disent dans toutes les langues, on s’en fout de vous, nous on s’aime, pour résumer.
Mon ami, je lui ai vidé tout ce qu’un corps peut contenir de larmes et de morve dessus.
Parce que tu sais qu’une bougie, c’est au moins une, et généralement plusieurs personnes qui ont pris le temps de venir, se recueillir.
Des bougies, il y en a quelques milliers.
Il y a des fleurs, des photos, des poèmes écrits à la main baignés de la lumière de ces bougies.
Quelqu’un a eu l’intelligence de mettre un drapeau du Liban sur la statue centrale, bien en vue, preuve que même si la télé n’en parle pas, la vérité c’est qu’on pense à eux autant qu’à nous.
Je me suis fait surprendre par un frisson en sentant la chaleur des petites flammes contre ma paume quand j’ai déposé la mienne.
Mais surtout ce silence.
Le silence est un moyen de communication trop souvent ignoré.
Plus tôt, place de la Sorbonne, c’était un silence grave et solennel.
Un garde à vous d’honneur auditif.
Ici le silence est toujours grave mais il est doux.
Dans la nuit, c’est un silence de lieu de prière. Il n’est troublé que par le frôlement des tissus de nos manteaux, des mains qui caressent les épaules, des bruits de pas feutrés, la rumeur de la ville derrière nous.
Et d’un coup j’ai plus eu envie d’insulter personne.
Ça aurait été trahir ce que je voyais.
a
L’humilité. Le respect. Et cette immense, immense douceur.
Et ça, ça ne se gueule pas, ça ne s’exhibe pas.
C’est juste là, c’est tout, et ressentir ça, ça se passe de tout mot.
a
Les images sont rapides et violentes, les mots jaillissent tous en même temps dans un flot violent, ininterrompu qui nous laisse hagards. Eux ! Ils disent ! Eux !
Mais qu’ils ne parlent que d’eux ne me prouve qu’une seule chose, c’est qu’ils sont une exception. Quelle serait l’intérêt de répéter en boucle à quel point les actes sont violents si nous l’étions ?
Il y a répétition parce qu’il y a inconcevable.
« 128 morts. Paris. » « 128 morts. Paris.» « 128 morts. Paris.».
La télé nous le répète comme notre cerveau pour nous le faire réaliser.
Ici l’énonciation s’explique par l’exception. Parce que c’est nouveau. Parce que ça n’est pas habituel. Si ils étaient une majorité, on ne soulignerait pas la violence de leur propos, puisqu’elle serait déjà notre.
Alors ils répètent, répètent, répètent. Jusqu’à ce que les mots se vident de substance.
Parce qu’on pense encore plus aux personnes là-bas dont c’est le quotidien depuis des mois, aux meurtres, aux viols, au patrimoine détruit à la kalash.
Non, la majorité est silencieuse, parce que face au vide de sens, il n’y a pas un mot, pas une image qui ne vaille notre présence.
a